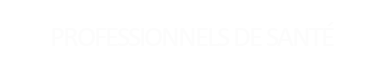1. Infection par inhalation
Suite à l'inhalation des mycobactéries, celles-ci sont phagocytées par les macrophages alvéolaires. La phagocytose se produit principalement à l'aide de récepteurs Certains récepteurs reconnaissent des antigènes de surface communs à tous les procaryotes alors que d'autres sont spécifiques d'antigènes mycobactériens ; par exemple, la molécule CD 14 interagit avec les lipo-arabinomannanes (LAM). Des anticorps et le facteur du complément C3 se lient aux molécules de surface du pathogène et sont reconnus par leur récepteur. Le macrophage alvéolaire étant incapable de tuer les mycobactéries phagocytées, ces dernières survivent et peuvent même se propager dans la cellule en bloquant la maturation des phagosomes. Les macrophages migrant vers les ganglions régionaux induisent une réponse T spécifique.
2. Induction d'une réponse immunitaire spécifique
Mycobacterium tuberculosis sécrète des protéines dans le phagosome; initialement, il s'agit de protéines exportées, puis de composants de la paroi cellulaire et enfin de protéines internes de la bactérie après son autolyse. Des fragments apprêtés de 10 à 20 acides aminés sont présentés par les molécules du CMH de classe II, des peptides plus courts de 8 à 10 acides aminés par celles de classe I. La molécule CD1, apparentée aux molécules du CMH de classe I, présente des lipides bactériens stimulant préférentiellement les cellules T CD4 et CD8 doubles négatives. Les antigènes mycobactériens contenant des groupes phosphates activent également les cellules Tγδ. Les molécules présentatrices de ces antigènes sont actuellement inconnues ; les ligands contenant des phosphates pourraient être directement présentés à la surface cellulaire.
3. Granulome :
Les cellules T CD4 activées sécrètent des chimiokines attirant les monocytes du sang et le TNF-α responsable de la formation du granulome. Au sein du granulome, l'activation du macrophage par les cytokines a pour conséquence l'élimination complète des mycobactéries intracellulaires. Néanmoins, le granulome contient en général une accumulation de pathogènes isolés de l'environnement. Cette isolation repose sur la formation d'un rempart marginal fibreux sous l'influence du TNF-α et sur la fusion des macrophages en cellules géantes de Langhans sous l'influence de l'IL-4. Bien qu'infecté, l'hôte ne développe pas de tuberculose symptomatique. Un équilibre entre les mycobactéries et le système défensif s'établit au sein du granulome. L'interféron γ active les fonctions tuberculostatiques des macrophages par l'intermédiaire d'une synthèse accrue de calcitriol activant les fonctions effectrices microbicides, Les macrophages activés sécrètent des métabolites actifs de l'oxygène et des protéases au niveau du centre du granulome qui se nécrose.
Les cellules T cytotoxiques CD8+ activées lysent les macrophages infectés qui libèrent alors leur contenu dans le centre nécrotique, où la faible concentration d'O2 et la présence de protéase inhibent la prolifération des mycobactéries.
Dans le cas d'une destruction cellulaire excessive, il existe une caséification du granulome : des lésions importantes de tissus se produisent, les mycobactéries peuvent pénétrer dans la circulation et disséminer dans la quasi-totalité des organes de l'hôte. Si le granulome rompu communique avec un conduit bronchique, les mycobactéries sont libérées dans l'arbre trachéo-bronchique et peuvent induire d'autres infections (« tuberculose ouverte »).
4. Complications :
Une perturbation de l'équilibre évoqué plus haut peut conduire à une extension de l'infection. La tuberculose des ganglions hilaires, l'épanchement pleural et les foyers dans les pointes pulmonaires (foyers de Simon) sont des complications typiques. La dissémination généralisée hématogène conduit à la formation de milliers de foyers dans les poumons, le foie, la rate et les méninges (tuberculose miliaire). La pneumopathie caséeuse et la septicémie de Landouzy sont en général létales.