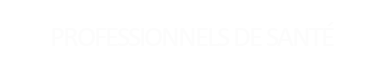Maladie de Crohn
La maladie de Crohn est une inflammation chronique granulomateuse qui peut atteindre l'ensemble du tractus gastro-intestinal. Elle se présente toutefois le plus souvent sous la forme d'une iléite terminale ou d'une entérocolite régionale. L'inflammation affecte toutes les structures de la paroi intestinale. Elle est remarquable par le caractère segmentaire des lésions et la tendance à former des fistules, des abcès ou des perforations. À la radiographie, le segment atteint apparaît épaissi, sténose et peu mobile (phénomène du tuyau d'arrosage). Les régions enflammées font saillies dans. la lumière du grêle (aspect de pavé). La progression des abcès et des fistules dans les structures avoisinantes (vessie ou peau) conduit à la formation de tumeurs inflammatoires agrégées. Les complications de la maladie incluent des sténoses, un iléus, un syndrome de malabsorption et la formation de fistules. La fréquence des carcinomes colorectaux et de l'amylose est accrue. La maladie de Crohn est associée aux types HLA-DR1 et DQw5. L'anamnèse révèle souvent un abus de nicotine, une période d'allaitement courte et une consommation élevée d'hydrates de carbone raffinés. Sous l'influence de stimuli bactériens, la production d'IL-12 s'accroît au niveau de la muqueuse intestinale qui intervient dans la différenciation des cellules TH1. La forte activité TH1 de la muqueuse a pour conséquence une élévation des concentrations d'IFN-γ, de TNF-α et d'IL-2. L'analyse des sous-classes d'IgG révèle une augmentation d'anticorps IgG2 qui fixent des antigènes bactériens. Cela a conduit à l'hypothèse que la maladie de Crohn représenterait une réponse immunitaire excessive aux antigènes exogènes dans l'intestin.
Les poussées sont traitées par la sulfasalazine, le 5-aminosalicylate et les stéroides. Le traitement de fond peut faire appel à l'azathioprine, au méthotrexate et à la ciclosporine A entre les poussées. Ce traitement est maintenu à faible dose pour prévenir les récidives. En cas de complication ou d'évolution résistante au traitement, la chirurgie préservant au mieux l'intestin est parfois nécessaire.
Rectocolite hémorragique
La recîocolite hémorragique {colite ulcéreuse) est une maladie chronique récurrente du côlon se présentant sous la forme de diarrhées mucohémorragiques, d'ulcérations superficielles de la muqueuse, avec une extension continue et rétrograde, de rectale à proximale. La cicatrisation des ulcérations s'accompagne d'un aplatissement de la muqueuse et d'un appauvrissement en cellules caliciformes. Une régénération excessive mène à la formation de pseudo-polypes. Au lavement baryte, on observe une diminution des haustrations et un aspect dentelé atypique. Le mégacôlon toxique et le carcinome colorectal constituent des complications réputées. La rectocolite hémorragique peut être accompagnée d'une uvéite et d'une arthrite. Elle peut être associée à une néphropathie glomérulaire à dépôts intercapillaires d'IgA, à une hépatite autoimmune et enfin à une cirrhose biliaire primitive. La muqueuse présente une concentration élevée d'IL-5 due à une forte activité TH2. Parmi les sous-classes d'IgG, les types IgG1 et IgG3 sont augmentés. La détection d'ANCA et l'association à d'autres maladies auto-immunes suggèrent que la rectocolite est une maladie auto-immune.
Les poussées aiguës sont traitées par la sulfasalazine et l'acide 5-aminosalicylique. Ces médicaments inhibent la synthèse des prostaglandines et des leucotriènes mais interviennent à un stade très tardif dans les mécanismes physiopathologiques. Une «guérison» chirurgicale peut être obtenue par la rectocolectomie totale.