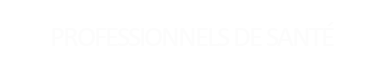La France fait partie des pays les plus touchés par le sida en Europe, avec l’Espagne, le Portugal et l’Italie. Depuis le début de l’épidémie, 53 095 personnes ont développé la maladie en France (au 31 décembre 2000), et 31 554 en sont mortes, d’après le dernier rapport du Ceses (Centre européen pour la surveillance épidémiologique du sida) et de l’InVS (Institut de Veille Sanitaire). L’incidence de la maladie est élevée en France, avec 26,3 cas par million d’habitants sur l’année 2000, contre 4,3 en Allemagne, 8,8 en Belgique ou au Danemark, mais davantage encore au Portugal (104,2) et en Espagne (63). Les pays du Nord de l’Europe, qui ont dès le début de l’épidémie entrepris de grandes campagnes de communication et réfléchi à la politique de réduction des risques, sont de fait beaucoup moins touchés que les pays du Sud. « La progression variable de l’épidémie dans les divers pays d’Europe est liée à cette incapacité à raisonner en termes de santé publique pour les pays du Sud, davantage préoccupés du débat sur la sexualité et le préservatif », déplore Arnaud Simon, l’un des responsables de la prévention pour l’association Aides.
La situation française s’explique par des mesures insuffisantes ou qui ont trop tardé pour prévenir les contaminations : atermoiements des politiques d’organisation du dépistage, timidité voire inefficacité des campagnes d’information et de communication en direction des groupes à risques, décisions tardives en matière de réduction des risques pour les usagers de drogues injectables... « Le sentiment qui domine est que l’engagement des pouvoirs publics français dans une première campagne de préven-tion a été tardif », souligne la sociologue Geneviève Paicheler dans un rapport de recherche sur la communication publique sur le sida remis en février 2000 à l’ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida). « L’un des facteurs qui auraient contribué à freiner cet engagement tient probablement aux réactions violentes émanant de groupes catholiques conservateurs visà-vis d’une campagne contre les MST menée en 1986 dans quelques départements », analyse-t-elle.
Des campagnes d’information trop tardives
De fait, les premières campagnes de prévention n’ont été lancées en France qu’en 1987. De plus, il a fallu attendre la campagne de l’été de 1995 pour voir aborder les thèmes de la toxicomanie et de la diversité des relations sexuelles dans des médias destinés au grand public. Quoi qu’il en soit, l’impact de ces campagnes de prévention est d’autant plus difficile à évaluer, en France, que le nombre de nouvelles contaminations par le VIH n’est toujours pas connu.
Les chiffres de prévalence du sida ont permis notamment, par extrapolation, d’évaluer le nombre de personnes séropositives. Il tournerait, aujourd’hui en France, autour de 120 000. Compte tenu des chiffres de l’activité de dépistage, le nombre de nouvelles contaminations annuelles est estimé à 5 000.
Mais les outils permettant un véritable suivi ne sont toujours pas disponibles. Beaucoup de pays européens se sont dotés d’un système permettant de suivre l’épidémie par une déclaration obligatoire des cas d’infections, et donc d’adapter éventuellement les campagnes de prévention en direction des groupes les plus touchés. Mais, dans l’Hexagone, c’est seulement en mai 2001 qu’a été décidée la déclaration obligatoire de la séropositivité liée à la contamination par le VIH, la maladie sida étant à déclaration obligatoire depuis 1986.
Le décret est sorti, mais selon l’InVS, le dispositif de recueil des données ne pourrait être opérationnel qu’en 2002.
Quelles que soient ces imprécisions, on ne peut contester une baisse nette de la vigilance dans la population. Un relâchement des comportements de prévention, notamment au sein de la communauté homosexuelle, a été observé. Les associations de lutte contre le sida ont été les premières à le signaler. Une enquête dite « enquête presse gay 2ooo », du sociologue Philippe Adam, est venue confirmer ce constat.
Les recrudescences de la gonococcie et de la syphilis ont également été mises en évidence. Enfin, à Paris, les CDAG (Centres de Dépistage Anonyme et Gratuit) ont enregistré en 1999 et 2000 une augmentation significative du nombre de cas de séropositivité dépistés, notamment chez les homosexuels masculins. L’abandon des pratiques à moindre risque est observé depuis l’apparition, en 1996, d’associations antirétrovirales plus puissantes, lesquelles ont transformé la perception de la maladie. « Le sentiment croissant d’indifférence de l’opinion publique à l’égard de l’épidémie de VIHsida explique en grande partie cette évolution alarmante », notait le CNS (Conseil National du Sida) dans un communiqué d’octobre 2000. Ce sentiment est largement fondé sur la perception erronée selon laquelle, grâce aux progrès thérapeutiques enregistrés depuis 1996, le sida ne serait plus qu’une maladie « Chronique ». Il est aussi le fruit de l’engagement atténué, au moins en apparence, des pouvoirs publics en matière de VIH/sida.
Face à ce constat désolant, les associations sont d’autant plus critiques que la dernière campagne publique de prévention a été interdite cet été par le gouvernement. Selon les associations, deux spots télévisés auraient été jugés trop crus par les services d’information du Premier ministre. Dans un communiqué commun, ActUp, Aides, la Ligue des droits de l’homme et Sida Info Service dénoncent cette « censure », estimant que les spots interdits abordaient pour la première fois, « la sexualité sans détour, sans puritanisme, ni voyeurisme ».
Une banalisation dangereuse
« Le sida s’est banalisé dans la population et rien, dans les discours publics, n’est venu contrecarrer l’optimisme général, plaide Jérôme Martin, vice-président d’Act-Up. Il faut communiquer sur ce que cela veut dire de vivre avec le virus, les traitements, les effets secondaires.... Enfin, il faut rappeler clairement que le seul moyen de se protéger reste le préservatif ». Les associations réclament ainsi des campagnes réalistes et percutantes, sur le modèle de celles qui ont été récemment élaborées pour la prévention routière. « Il a fallu attendre des années et des milliers de morts sur la route pour que l’on signifie clairement les conséquences des comportements à risque au volant », déplore Yves Ferrarrini, directeur de Sida Info Service.
Outre la timidité des campagnes de prévention, les acteurs sur le terrain observent une inadéquation dans le temps entre les messages diffusés et la réalité de l’épidémie. Ainsi, les données de l’InVS montrent que les femmes sont de plus en plus touchées par la maladie. Stable aux alentours de 20 % depuis 1993, la proportion des femmes parmi les nouveaux cas de sida est passée à 25 % en 1999, puis à 31 % aujourd’hui. En 1997, la Direction générale de la santé organisait un colloque sur les femmes et l’infection à VIH, au cours duquel plusieurs intervenants plaidaient en faveur d’une prévention ciblée. Et pourtant, ce n’est qu’en mars 2001 que le CFES (Comité Français d’Éducation pour la Santé) a lancé sa première campagne ciblée en direction des femmes. De même, alors que la situation épidémiologique est particulièrement alarmante chez les personnes d’origine étrangère vivant en France, les campagnes de prévention destinées à ces personnes n’ont été mises en oeuvre qu’à partir de 1998 (brochures en langue d’origine, campagnes sur les radios communautaires, programmes expérimentaux de médiateurs salariés). Près de 15 % des cas de sida déclarés depuis le début de l’épidémie touchent des personnes d’ origine étrangère, alors que celles-ci représentent à peine 6 % de la population totale.
Les hommes d’origine étrangère sont deux fois plus touchés que les Français, et les femmes 3,5 fois plus. L’accès au dépistage et aux soins est aussi beaucoup plus tardif chez les personnes étrangères vivant en France que chez les Français, puisque 42 % d’entre elles ne connaissent pas leur statut sérologique au moment du diagnostic du sida, contre 22 % des Français. « Contrairement à d’autres pays européens, la France n’a pas coutume d’appuyer ses actions de santé publique sur des informations en langue d’origine, se défend le ministère de l’Emploi et de la Solidarité dans une des brochures diffusées cette année par le CFES. Il n’était donc pas évident a priori de développer, pour la première fois et sur un sujet comme le sida, des informations spécifiquement tournées vers les migrants ».
La question de la présence des personnes d’origine étrangère, pour permettre une meilleure identification dans les campagnes de communication grand public, reste toujours d’actualité. Certains craignent une stigmatisation, mais d’autres acteurs de prévention, notamment les associations Act-Up et Migrants contre le sida, préconisent cette démarche pour atteindre des publics qui ne se reconnaissent toujours pas dans les campagnes de prévention.
En France, les usagers de drogues injectables ont également été frappés de plein fouet par la maladie, et les taux de contamination sont, là encore, supérieurs à ceux qu’enregistrent les pays du Nord de l’Europe. Alerté par la situation, le CNS soulignait dès 1993 la nécessité de renforcer la politique de prévention et de protection de la santé publique, plutôt que de poursuivre la répression de l’usage de drogues. Au début des années 1990, plus d’un tiers des usagers de drogues injectables étaient contaminés par le VIH. Dès la fin des années 1980, plusieurs pays d’Europe ont multiplié la mise en place de programmes d’accès aux produits de substitution et d’initiatives visant à amoindrir les risques liés aux pratiques d’injection.
En France, la loi du 31 décembre 1970, qui constitue le cadre législatif de politique de lutte contre la drogue, est particulièrement répressive. Dans ce contexte, les mesures ont été prises tardivement : vente libre des seringues (1987), développement de l’accès au traitement de substitution par la méthadone (1994), décret permettant aux associations de distribuer gratuitement des seringues (1995), mise sur le marché du traitement de substitution Subutex, prescrit pas les médecins de ville (1996). Le CNS parle de fait « d’un retard considérable pris dans le déploiement des moyens à même de contrarier la progression des contaminations par le VIH ».
Persistance des pratiques à risque
Ces mesures auraient contribué à diminuer la prévalence de l’infection par le VIH chez les usagers de drogues, estimée aujourd’hui à 20 %. Cependant, dans son avis de juin dernier, le Conseil estime que plusieurs indicateurs semblent confirmer la persistance de pratiques à risque et font craindre non seulement une reprise de l’épidémie de VIH, mais aussi le développement d’autres contaminations. Le CNS dresse un bilan particulièrement négatif de la loi de 1970, rejoignant en ce sens les associations de lutte contre le sida qui ne cessent depuis des années de dénoncer ses effets pervers sur la santé publique. Il note notamment une augmentation constante du nombre d’usagers de drogues illicites et la dégradation de l’état de santé de ces personnes. « Le maintien de l’ambiguïté entre démarche de protection de la santé et répression de l’usage des stupéfiants participe à entretenir un certain retard dans la réalisation d’objectifs ambitieux », déplore le CNS.
Pour le Conseil, le contexte de la prise en compte des usages de drogues demeure en effet marqué à ce jour par la modestie et l’éparpillement des actions de prévention primaire et secondaire et la fragilité des initiatives visant à accueillir, à prendre en charge et à accompagner les usagers de drogues dans leurs démarches médicales et sociales.
Plaidant pour une redynamisation de la politique de réduction des risques, le CNS demande par ailleurs une dépénalisation de l’usage des drogues, en raison d’une part de l’inefficacité des peines prononcées, et d’autre part de l’amplification des risques sanitaires à laquelle peut participer l’action répressive.