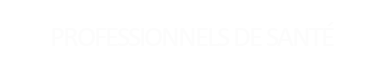La rétroaction (« feedback ») est un processus par lequel la réponse à un signal (par exemple, la réponse de la cellule à une stimulation hormonale) influence, par voie de retour, la structure émettrice du signal (dans l'exemple, la glande endocrine). Dans la rétroaction positive (rare), la réponse va amplifier le signal original ce qui conduit à une réponse elle-même amplifiée, et ainsi de suite. Dans la rétroaction négative, la réponse du récepteur va réduire le signal déclencheur original. Comme la plupart des mécanismes de régulation de l'organisme, les actions des hormones sont soumises à une telle rétroaction négative.
Les releasing hormones de l'hypothalamus (par exemple, la CRH) provoquent la libération de l'hormone glandulotrope correspondante du lobe antérieur de l'hypophyse (dans l'exemple, l'ACTH ou corticotropine) qui, elle-même, influence la glande endocrine périphérique (dans l'exemple, la corticosurrénale). L'hormone effectrice excrétée agit non seulement sur la cellule-cible mais encore inhibe en retour la libération de la releasing hormone par l'hypothalamus, avec pour résultat une diminution de la quantité d'hormone terminale libérée. L'inhibition de la libération de la releasing hormone est ainsi assurée, etc.
La rétroaction peut également s'effectuer si, par exemple, l'hormone du LA inhibe l'hypothalamus ou bien si l'hormone du LA ou les cellules produisant l'hormone terminale sont inhibées par l'hormone terminale elle-même, comme c'est le cas avec la TSH ou l'ACTH (autoinhibition). Le métabolite contrôlé par l'hormone (par exemple, la concentration plasmatique de Ca2+) peut luimême régler la libération de cette hormone. La rétroaction concerne également les signaux nerveux (circuit de contrôle neuroendocrine), par exemple dans te contrôle endocrine de notre conduite alimentaire (niveau de glycémie → faim ; homéostasie osmotique et hydrique → soif. etc.).
Les hormones de « rang supérieur » dirigent non seulement la synthèse et la libération de l'hormone effectrice mais encore influencent la croissance des glandes endocrines périphériques. Par exemple, la concentration de l'hormone effectrice dans le sang peut être encore trop faible malgré une synthèse et une libération maximales par les cellules glandulaires présentes. Ces cellules vont, alors, se multiplier jusqu'à ce que l'effet de rétroaction de l'hormone effectrice synthétisée soit suffisant pour inhiber la glande endocrine supérieure correspondante. Une telle hypertrophie compensatrice (croissance compensatrice) d'une glande endocrine périphérique peut aussi s'observer, par exemple après ablation chirurgicale partielle de la glande. La glande en question augmente en taille et en fonction endocrine jusqu'à ce que sa sécrétion initiale soit rétablie.
Les hormones de synthèse administrées (par exemple la cortisone) présentent la même action inhibitrice sur la libération des hormones glandulotropes (dans l'exemple. l'ACTH) que les hormones libérées physiologiquement par la glande périphérique (dans l'exemple, la corticosurrénale). L'administration continue d'une hormone périphérique entraîne ainsi une inhibition et une régression du rythme de production normale de cette hormone : atrophie compensatrice.
On appelle phénomène de rebond (« rebound phenomenon »), une libération, passagèrement sus-normale, d'une hormone de rang supérieur (LA) en réponse à une interruption de la production de l'hormone périphérique.
La principale action des hormones sur les cellules-cibles est de contrôler leur métabolisme, ceci de 3 façons :
- modification de la configuration des enzymes (mécanismes allostériques), qui a pour conséquence une modification directe de l'activité enzymatique,
- inhibition ou stimulation (induction) de la synthèse enzymatique,
- modification de la disponibilité du substrat aux réactions enzymatiques, par exemple, par modification de la perméabilité membranaire.
L'insuline utilise ces trois voies pour modifier la disponibilité intracellulaire du glucose. Pour cela, un «programme» cellulaire est initié par la phosphorylation intracellulaire des sous-unités β des récepteurs membranaires à l'insuline lorsque cette dernière entre à leur contact