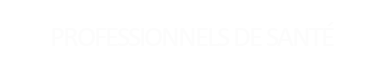Hépatite auto-immune
L'étiologie de ce syndrome reste inconnu. Le diagnostic repose sur plusieurs critères. La maladie est plus fréquente chez les femmes et est associée aux allèles HLA-DR3 et DR4.
L'histologie révèle un aspect typique d'hépatite chronique et la sérologie montre une hypergammaglobulinémie. Les immunosuppresseurs améliorent les symptômes. L'hépatite auto-immune est souvent associée à d'autres maladies autoimmunes : polyarthrite rhumato'ide, glomérulonéphrite, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn et thyroidite de Hashimoto. Dans 50 p. 100 des cas, elle s'accompagne également d'une vascularite, d'une cryoglobuhnémie, et enfin d'un syndrome de Gougerot-Sjôgren. Les patients présentent les symptômes courants des atteintes hépatiques : ictère, prurit, nausées, diarrhées, fièvre et hépatosplénomégalie. Les transaminases sont élevées et il existe des signes de cholestase.
Cette forme d'hépatite est un syndrome d'auto-immunité dirigée contre des structures des tissus hépatiques. Le rôle physiopathologique des auto-anticorps détectables est inconnu. Ils reconnaissent des protéines structurelles ou des enzymes microsomiales du foie (liver-kidney microsomal antibodies, LKM). LKM-1 est un anticorps reconnaissant le cytochrome P450 IID6, une enzyme métabolisant des médicaments tels que les bêtabloquants, les antiarythmiques et les antidépresseurs. LKM-1 est souvent associé aux anticorps dirigés contre HCV. L'hépatite auto-immune pourrait donc être à l'origine une maladie induite par des virus hépatotropes.
Les auto-anticorps permettent le diagnostic. Le diagnostic différentiel doit néanmoins exclure les hépatites virales ainsi que les hépatopathies d'autre origine, par exemple dues aux médicaments, à l'alcool ou à des déficits enzymatiques héréditaires tels que le déficit en α1-antitrypsine et la maladie de Wilson. Un typage des allèles HLA doit toujours être effectué. Le traitement immunosuppresseur repose sur la prednisolone seule ou associée à l'azathioprine.
Cirrhose biliaire primitive (CBP)
La CBP ou cholangite chronique destructive non suppurative est une inflammation des petites voies biliaires interlobulaires et atteint surtout les femmes de plus de 40 ans. Outre les signes de cholestase, on observe une augmentation du taux sénque de cholestérol avec éventuellement formation de xanthomes. On remarque également un ictère, un prurit, une hyperpigmentation de la peau et une mauvaise digestion hépatobiliaire. Les manifestations extra-hépatiques révèlent le caractère multisystémique de la CBP. Les atteintes du pancréas exocrine et des glandes lacrymales et salivaires justifient la désignation de «syndrome sec».
Dans la moitié des cas, la CBP est associée à un syndrome de Gougerot-Sjôgren mais fréquemment aussi à d'autres maladies auto-immunes. Le sérum contient des anticorps anti-mitochondries (AAM). Ils reconnaissent principalement la sous-unité E, du complexe de la pyruvate déshydrogénase. Le rôle des anticorps dans la physiopathologie est incertain. La maladie pourrait être induite par une infection bactérienne. Les immunosuppresseurs sont en général sans
effet.Cholangite primitive sclérosante (CPS)
La CPS est caractérisée par une inflammation chronique fibrosante des voies biliaires intra- et extra-hépatiques. L'épaississement des parois et les sténoses provoquent une cholestase. La maladie est plus fréquente chez les hommes et est associée à HLA-B8 et DR3. La moitié des patients souffrent simultanément d'une rectocolite hémorragique. Le diagnostic repose sur la détection des ANCA et sur la radiographie des voies biliaires. Comme pour la CBP, le traitement est symptomatique.