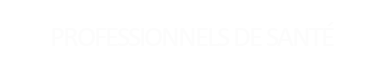Lutte contre le tabac : l’offensive se poursuit
Ces dernières années, notre pays a réalisé des percées majeures dans la lutte contre le tabac. Les bénéfices attestés par la réduction de la proportion de fumeurs apparaît durable chez les femmes et chez les plus jeunes. Avec 30 % de fumeurs dans la population générale, la France reste toutefois encore loin de l’objectif de descendre à 20 % instauré par le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et des niveaux atteints par certains autres pays développés comme l’Islande (19,8 %), le Canada (18 %) ou la Suède (16 %).
De tels progrès requièrent une attention particulière des pouvoirs publics et ne sauraient reposer sur la seule volonté des individus. La publication du décret du 15 novembre 2006 a permis de franchir une nouvelle étape décisive en ce sens. L’interdiction de fumer dans les lieux publics s’est appliquée dès février 2007 aux entreprises, mais aussi aux établissements scolaires et aux lieux de soins.
Comme chaque année, le BEH consacre un numéro aux données relatives à la lutte contre le tabagisme à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai. Or, cette année, l’OMS a décidé de retenir le thème des espaces sans tabac. Certes, il est un peu tôt pour évaluer l’impact en France de la réforme réglementaire récente, notamment au plan sanitaire. Cependant, l’article de Dautzenberg et coll., à partir de premières indications disponibles fournies par l’Office français de prévention du tabagisme (OFT) au travers d’une enquête sur l’évolution du tabagisme sur le lieu de travail, montre que cette mesure a répondu à une attente des Français et n’a pas soulevé de grandes difficultés.
Les autres travaux présentés font état de données préalables à la publication du décret mais qui permettent de cerner certaines évolutions. Karsenty et coll. présentent les résultats de deux études menées dans les lycées et les établissements de soins. Dans les lycées, l’amélioration est sensible. La proportion des lycées qui ont interdit de fumer de manière absolue aux élèves est passée de 14 % en 2002 à 40 % en 2006 et, de manière concomitante, la prévalence tabagique des lycéens a fortement chuté. Ces progrès sont sûrement à mettre en lien avec l’intensité des efforts publics de lutte contre le tabac en 2003 et 2004 et la mobilisation liée au Plan Cancer, notamment auprès des proviseurs. En revanche, dans les établissements de soins, la situation est plus délicate, Karsenty et coll. rapportent que les deux-tiers des hôpitaux publics interrogés au printemps 2006 déclaraient des difficultés d’application de la réglementation de 1992. Une nouvelle évaluation sera très vite nécessaire pour vérifier si l’interdiction totale du tabac dans les établissements de soins est au rendez-vous.
L’application de la loi Évin sur le tabac dans les hôpitaux publics français en 2006
Introduction
Pour des raisons pratiques et symboliques, les entreprises agissant dans le domaine de la santé et de la médecine sont depuis longtemps considérées comme des lieux où la lutte contre le tabagisme doit être exemplaire. Le document de référence pour la stratégie anti-tabac au niveau européen recommande depuis 2002 « l’interdiction du tabagisme dans tous lieux de prestation de soins de santé, leurs locaux et leur périmètre situé à l’extérieur » .
En France, l’article 4 du décret du 12 septembre 1977 découlant de la loi du 9 juillet 1976 dite « loi Veil » prohibait explicitement l’usage du tabac dans les établissements de santé pour tous les locaux destinés à accueillir, soigner ou héberger des malades.
Mais son application et l’évaluation qui pouvait en être faite n’ont jamais été mises en œuvre au niveau national. Ce décret fut abrogé en 1992 et la spécificité des établissements de santé disparut des dispositifs réglementaires de lutte contre le tabac pendant quatorze ans, sauf à prendre en compte les circulaires de la Direction des hôpitaux et de la Direction générale de la santé (DGS).
A partir du décret du 15 novembre 2006 remplaçant les dispositions de celui du 29 mai 1992 pris en application de la loi du 10 janvier 1991, dite « loi Évin », l’interdiction de fumer dans les établissements de santé est totale depuis février 2007. La réglementation précédente, issue du décret de 1992, permettait que des emplacements dédiés soient autorisés aux fumeurs, patients, visiteurs ou personnels dans des conditions laissées à l’initiative locale.
Dans cette période précédant le décret, la DGS,– qui l’a financé,– et la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) ont souhaité établir pour la première fois un état des lieux de l’application de la réglementation du tabagisme au sein des hôpitaux français. L’enquête qui a été menée à cette fin a établi un état de la situation au sein des établissements publics et des centres de lutte contre le cancer au cours des mois de mars et avril 2006. Les résultats de cette étude descriptive, dont cet article présente quelques éléments significatifs, pourront éclairer dans l’avenir les efforts mis en oeuvre par les établissements hospitaliers pour appliquer le décret novateur de 2006.
Objet et méthode
Il s’agissait de connaître le degré d’application des réglementations limitant l’usage du tabac dans les établissements hospitaliers français. Une estimation des comportements, connaissances et opinions des trois acteurs concernés, – patients, personnels et direction,– sur l’ensemble des problèmes posés par l’application ou l’inapplication des règles était également recherchée à une échelle statistiquement significative.
Une enquête par sondage a été réalisée à partir de l’annuaire Politi des établissements publics hospitaliers et Centres de lutte contre le cancer . Cette base couvre l’ensemble des départements français incluant les quatre départements d’outre-mer. Un échantillon de 450 établissements a été constitué par tirage aléatoire au sein de deux strates différenciant les Hôpitaux locaux, qui représentent le tiers de la base, et les autres catégories d’établissements.
Les taux de tirage ont été raisonnés : 25 % pour les HL et 40 % pour les autres catégories. Les établissements sélectionnés ont été sollicités pour participer à une enquête très complète impliquant la réponse en mode auto-administré, sauf exceptions, à trois types de questionnaires s’adressant respectivement à la direction, aux personnels (10 questionnaires distribués selon une règle aléatoire) et aux patients (15 questionnaires distribués un jour donné en procédure de sortie, sauf en HL : cinq questionnaires administrés en face-à-face par tirage aléatoire). Au sein de l’échantillon-cible, 316 établissements ont répondu positivement par une participation aux trois types de questionnaires, établissant le taux de réponse global à 70 % (CHU : 81 %, CHS : 58 %). Les dix questionnaires distribués auprès des personnels de chaque établissement ont été renvoyés dans des proportions variables mais satisfaisantes (7,6 en moyenne).
Les questionnaires distribués aux patients sont revenus au nombre de 12,3 en moyenne lorsque l’objectif désigné était 15 (établissements non HL) et au nombre de 4,7 pour un objectif de cinq (hôpitaux locaux). Les questionnaires de 2 402 membres du personnel et de 3 465 patients ont été exploités. L’exploitation des données a privilégié le croisement des réponses avec la catégorie d’appartenance de l’hôpital selon une typologie en cinq catégories. Les résultats relatifs aux centres de lutte contre le cancer, peu nombreux et très spécifiques, n’ont pas été systématiquement analysés et reproduits.
Résultats
Les défaillances de signalisation de l’interdiction de fumer - En 2006, seules les directions des CHU déclaraient en majorité que « dans l’enceinte de l’établissement, tous les locaux clos et couverts (ou la plupart d’entre eux) posséd(ai)ent la mention « interdit de fumer » à l’exception des zones ou des locaux spécialement autorisés ». Les hôpitaux locaux et les CHS à dominante psychiatrique sont particulièrement défavorisés en termes de signalisation. Dans les CH, l’attention est concentrée sur les locaux sensibles. Quoique la définition de ce type de locaux n’ait pas été donnée dans l’enquête, il est sous-entendu et confirmé par les réponses à d’autres questions que sont visés les lieux d’attente, de circulation ou les locaux à usage professionnel ne recevant pas de patients.
Les défaillances de la signalisation peuvent être mises en relation avec l’imprécision générale des attributions du contrôle de la limitation du tabagisme dans l’organigramme des établissements. À la question « Les acteurs ayant la responsabilité locale du contrôle de la bonne application des règles sont-ils désignés dans un document officiel ? », 78 % des directions répondent négativement. Lorsque la réponse est positive, la nature du texte précisant cette attribution de responsabilité est très variable (circulaire directoriale : 16 %, règlement intérieur : 11 %, délibération du CHSCT : 9 %) et le nombre de non-réponses très important.
Résultats
L’application des règles - L’appréciation par les directions d’hôpital de la bonne observance des réglementations révèle a nouveau les différences entre catégories d’établissements. D’une manière générale, les personnels sont considérés comme plus observant que les patients. Hormis la spécificité des CHS, la taille des établissements et la taille des communes au sein desquelles ils sont implantés peuvent jouer un rôle défavorisant malgré l’importance relative de leurs efforts. S’agissant d’opinions, on pourrait penser que les exigences d’observance des directions sont variables, pouvant être plus réduites là où les réglementations sont difficiles à appliquer.
Néanmoins, les réponses à une question posée à l’ensemble des patients fumeurs (N = 1 235) montrent que les appréciations différenciées des directions correspondent aux différences des taux de transgressions déclarées par le fumeurs. À la question « Si vous êtes fumeur(euse), pendant votre séjour ou passage à l’hôpital, vous est-il arrivé de fumer à l’intérieur de l’établissement en dehors des lieux mis à la disposition des fumeurs ? », les patients fumeurs ont reproduit le même classement des établissements que celui établi par les directeurs.
Le questionnaire auprès des directions demandait aux établissements s’ils appartenaient au Réseau Hôpital sans tabac (RHST). Il a donc été possible d’établir que 78 % des directions des 181 établissements de l’échantillon appartenant à ce réseau déclaraient être « tout à fait » ou « plutôt d’accord » sur le fait que la réglementation était « bien respectée par le personnel ». Une proportion strictement identique (78 %) des directions des 110 établissements non adhérents faisait les mêmes déclarations.
En 2006, l’application de la réglementation était ressentie comme difficile par la moitié de l’ensemble des directeurs d’établissement. Mais les différences entre catégories d’établissements étaient également très marquées : dans 55 % des CHU, 43 % des CH, 29 % de HL et 84 % des CHS, les directions déclaraient que l’application était « plutôt difficile » ou « très difficile ».
Résultats
Exposition au tabagisme passif - Les réponses des personnels à la question « Sur votre lieu de travail, êtesvous gêné(e) par la fumée d’autres membres du personnel ? » ne permettent pas d’induire un nombre d’établissements totalement sans tabac. Mais 76 à 82 % des personnels ne déclarent pas la question « sans objet » dans leur environnement, qu’ils soient ou non exposés directement à la fumée de tabac ou qu’ils trouvent cela gênant ou non. Parmi les personnels « pas du tout » gênés par la fumée se retrouve l’essentiel des effectifs de fumeurs.
Les Centres de lutte contre le cancer dont les résultats ne sont pas rapportés dans le tableau connaissent vraisemblablement une situation plus favorisée (39 % des personnels y déclarent que personne ne fume).
En 2006, 67 % des directeurs des hôpitaux de cet échantillon considéraient que le tabac était « un problème dans (leur) établissement ». Seulement 47 % des personnels partageaient cette opinion.
Quoi qu’il en soit, cette opinion est de fréquence croissante avec la taille de l’établissement mesurée en nombre de lits.
Malgré une opinion extrêmement favorable à la réglementation en vigueur en 2006 (95 % d’opinions favorables chez les personnels comme chez les patients), 44 % des personnels et 33 % des patients ne trouvent pas cette réglementation efficace pour diminuer le tabagisme.
Résultats
Opinions sur l’interdiction totale de fumer - Sollicités de donner leur opinion sur la formule suivante : « Je pense que la réglementation doit évoluer vers une interdiction totale de fumer à l’hôpital (aucun espace autorisé) », les trois catégories de répondants ont donné des réponses sensiblement différentes. Une majorité des personnels, excédant de beaucoup la proportion de fumeurs en leur sein, se déclare « pas du tout » ou « plutôt pas d’accord » avec la perspective d’un hôpital sans tabac.
Au sein des personnels, les médecins et sagefemmes sont les seules catégories professionnelles nettement favorables à une interdiction totale de fumer (63 % d’accord). Parmi les patients, seuls ceux des CHS sont minoritaires en faveur de cette perspective (35 %).
Discussion
Peu de pays ont mis en place une évaluation systématique des efforts faits pour parvenir à un hôpital sans tabac. Aux États-Unis, l’évaluation demandée par la commission d’accréditation des organismes de santé pour connaître l’observance de l’interdiction totale de fumer à l’intérieur des bâtiments de santé à compter de Janvier 1994 a débouché sur une vaste étude qui a conclu à une satisfaction générale des critères,– souvent dépassés vers une plus grande rigueur. Il s’agit d’un cas unique. En 2004, un document du National Health Service britannique remarque qu’en 1992, il avait été demandé à toutes les composantes du NHS de devenir des entreprises sans tabac, mais qu’à ce jour, des recherches internes récentes montraient qu’en Angleterre 99 % des hôpitaux du NHS étaient dotés d’une politique anti-tabac mais que seuls 10 % d’entre eux étaient effectivement « sans tabac ».
L’enquête présentée ici s’inscrit harmonieusement dans le contexte européen de la dernière décennie où l’évaluation a été moins développée que les incitations à l’action. Ses fragilités méthodologiques repérées permettront d’avancer vers un modèle où la rigueur de l’évaluation irait de pair avec les progrès acquis dans les établissements à la suite du décret de 2006.
Conclusion
À la date de l’enquête, environ un quart de l’ensemble des établissements de l’échantillon semble mener une politique réussie d’exclusion totale du tabagisme. Après 14 années de mise en oeuvre de la loi Évin, les deux-tiers des établissements témoignent de difficultés notables à mettre en place les dispositifs réglementaires ou à les faire respecter.
Ces difficultés sont liées à la taille des établissements et à la dimension urbaine de leur implantation, à l’exception des CHS qui font état de difficultés qui seraient liées aux caractéristiques de leur activité.
Une nouvelle évaluation permettrait de repérer le rôle propre des instruments juridiques mis en œuvre au cours de cette période. On peut émettre l’hypothèse que l’absence de dispositions particulières aux établissements de santé dans le décret de 1992 a été néfaste aux politiques anti-tabac au sein des hôpitaux publics.