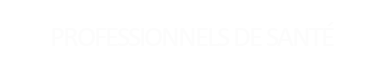Gastrite atrophique chronique de type A
La gastrite de type A est une maladie autoimmune caractérisée par des auto-anticorps dirigés contre les cellules principales et bordantes ainsi que contre le facteur intrinsèque. Elle atteint l'antre et le fundus de l'estomac et évolue vers une atrophie glandulaire avec achlorhydrie, et une réduction de la production du facteur intrinsèque. Après une longue phase peu symptomatique, la maladie se manifeste sous forme de troubles de la digestion et d'une carence chronique en vitamine B12 (anémie pernicieuse).
Elle s'accompagne d'une anémie hyperchromique macrocytaire avec hypersegmentation des granulocytes. L'examen neurologique révèle les signes d'une myélose funiculaire : perception diminuée des vibrations et ataxie ; dues à une atteinte des cordons postérieurs ainsi que, au stade tardif, paraparésie spasmodique des )ambes due à une dégénérescence de la voie pyramidale. L'achlorhydrie induit une hypergastrinémie à jeun et le tubage à la pentagastrine est fortement positif.
Les auto-anticorps dirigés contre les cellules principales peuvent être groupés en deux grands types:
- des anticorps dirigés contre un antigène microsomial (PCMA), dans le contexte d'un diabète de type 1 ;
- des anticorps dirigés contre un antigène de surface (PCSA) spécifiques d'une gastrite auto-immune de type A.
La gastrite de type A peut être associée à d'autres endocrinopathies auto-immunes telles que les thyroïdites de Basedow et de Hashimoto; elle est associée aux HLA-A3, B7, DR2 et DR4. L'anémie pernicieuse est traitée par l'administration parentérale de vitamine B12.
Maladie de Whipple
Cette maladie est due à une infection chronique par Tropheryma whippeli, un actinomycète à Gram positif retrouvé dans les phagosomes des macrophages de la flore intestinale. À l'examen histologique, le pathogène apparaît sous forme de corps d'inclusion PAS-positifs. Les macrophages deviennent turgescents, s'accumulent dans les canaux et les ganglions lymphatiques, bloquant ainsi les voies de drainage. Les lipides alimentaires ne peuvent donc plus être absorbés une malabsorption et une stéatorrhée se développent. Le syndrome peut s'accompagner de manifestations systémiques avec des arthralgies et une hyperpigmentation brune. Les altérations immunitaires sont vraisemblablement dues au syndrome de malabsorption. Le traitement repose sur l'administration de tétracyclines pendant 5 à 6 mois.
Maladie cœliaque
La maladie cœliaque est caractérisée par une réaction allergique chez des sujets présentant une prédisposition génétique vis-à-vis de la gliadine, protéine trouvée dans les céréales ; elle est associée à HLA-DR3 et B8. Elle provoque une inflammation auto-agressive qui atteint les filaments d'ancrage myo-épithéliaux de l'intestin.
On détecte des auto-anticorps dirigés contre l'endomysium et la réticuline ainsi que des anticorps contre la gliadine. La muqueuse de l'intestin grêle s'atrophie (fiât mucosa), et des infiltrais lympho-épithéliaux se développent. Un régime sans gluten corrige les symptômes cliniques.
Outre la malabsorption et la stéatorrhée, les complications comprennent une dermatite herpétiforme due à des auto-anticorps ainsi qu'un risque élevé de lymphomes malins développés à partir du tissu lymphoïde de la muqueuse. Les modèles physiopathologiques restent hypothétiques. Les gliadines pourraient avoir un effet similaire aux lectines, c'est-à-dire présenter une cytotoxicité indirecte pour l'épithélium intestinal. Selon une autre hypothèse, la gliadine serait reconnue par les cellules T CD8 de façon spécifique, ce qui provoquerait l'atrophie muqueuse par l'intermédiaire des cytokines.