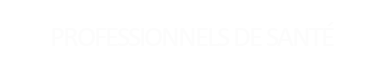La dernière partie du tube digestif est constituée du gros intestin (caecum et côlon, 1,3 m de long environ) et du rectum. La muqueuse du gros intestin est caractérisée par la présence de profondes invaginations (cryptes) recouvertes essentiellement par des cellules muqueuses, appelées cellules caliciformes.
Une partie des cellules superficielles (avec une bordure en brosse) sert à la réabsorption.
Le gros intestin sert de lieu de stockage pour le contenu intestinal (1er stockage : caecum et côlon ascendant ; 2e stockage : rectum). A son niveau, la résorption de l'eau et des électrolytes du contenu intestinal (chyme) se poursuit. Ainsi, les chymes de 500 à 1500 ml, qui apparaissent chaque jour dans le gros intestin, sont concentrés à 100-200 ml environ.
Motilité
Quand les aliments pénètrent dans l'estomac, la valve iléo-caecale se relâche, permettant à l'intestin grêle de vider son contenu dans le gros intestin (réflexe gastroiléal ou réflexe gastrocolique). Le gros intestin est le siège de différents mouvements mixtes locaux ; les fortes constrictions transversales sont des mouvements caractéristiques. Des mouvements péristaltiques de masse se produisent également toutes les 2 à 4 heures.
Les mouvements de masse requièrent l'intégrité du plexus myentérique. Normalement trois ou quatre de ces mouvements suffisent pour déplacer le contenu du côlon vers le rectum ; cependant ils ne servent qu'au transfert et ne sont pas en rapport avec la défécation.
Sur des radiographies, on peut observer le déroulement type des mouvements du gros intestin après absorption d'un chyme contenant de la baryte (substance de contraste) : on administre le produit de contraste à 7 h ; à 12 h, la substance se trouve déjà dans les dernières boucles de l'iléon et dans le caecum. Le début du repas de midi accélère la vidange de l'iléon. 5 minutes plus tard, un étranglement se forme à l'extrémité de la substance de contraste, puis, peu après, le côlon transverse est rempli par la substance qui est aussitôt à nouveau segmentée et donc malaxée par des constrictions transversales. Quelques minutes plus tard (toujours pendant le repas), l'intestin se resserre brusquement autour de la partie la plus avancée du contenu intestinal et l'entraîne très rapidement (A6-A8) jusque dans le sigmoïde : ce sont les mouvements péristaltiques de masse. Ces mouvements se déclenchent presque toujours après les repas ; ils sont dus à un réflexe gastrocolique et à des hormones gastro-intestinales. L'absorption terminale de l'eau s'effectue dans le rectum.
L'eau introduite artificiellement dans le rectum (lavement) peut être réabsorbée. Les médicaments (suppositoires) diffusent également dans le sang à travers la paroi intestinale. Les substances ainsi apportées sont donc soumises à l'influence de l'acide gastrique et des enzymes digestives ; en outre, elles contournent le foie. Le gros intestin n'est pas absolument indispensable : en cas de tumeurs, on peut en enlever une grande partie.
Défécation
La fermeture de l'anus (orifice terminal du tube digestif) est réglée par plusieurs mécanismes déclenchés par : la valvule de KohIrausch, qui s'insère entre deux valvules superposées. Au fur et à mesure que le rectum supérieur (ampoule rectale) est rempli par le contenu intestinal, des récepteurs de pression sont stimulés, ce qui déclenche le besoin de déféquer. La défécation correspond à la satisfaction volontaire (dans la majorité des cas) de ce besoin.
Pour cela, les muscles longitudinaux du rectum se contractent, les valvules se rejoignent, les deux sphincters de l'anus (anal intgerne à motricité involontaire, et anal externe à motricité volontaire et les muscles puborectaux se relâchent, l'intestin se rétracte et les muscles circulaires, aidés par la sangle abdominale, poussent les fèces et les évacuent.
Les fèces sont constitués pour 1/4 environ de substances sèches dont 1/3 proviennent de bactéries qui sont les hôtes physiologiques du gros intestin. La fréquence des défécations (de 3 fois par jour à 3 fois par semaine) varie beaucoup suivant les individus et dépend notamment de la quantité de fibres (cellulose par exemple) indigestibles qui a été ingérée. La cellulose est métabolisée par les bactéries intestinales en méthane et autres gaz, ce qui provoque les flatulences suivant, par ex. un repas de haricots.
Diarrhées
Des évacuations trop fréquentes de selles liquides (diarrhées) peuvent provoquer autant de troubles que des défécations trop espacées (constipation, constipation opiniâtre).
Bactériémie intestinale
A la naissance, le tractus intestinal est stérile, mais durant les premières semaines de la vie, il est colonisé par des bactéries ingérées oralement. L'intestin de l'adulte contient 1010-1012 bactéries par ml de contenu intestinal (la plupart exclusivement anaérobiques). La présence de bactéries dans l'intestin augmente l'activité de défense immunitaire intestinale (« inflammation physiologique »), et leur métabolisme est important pour l'« hôte ». Les sels biliaires et les hormones sexuelles par ex. sont déconjugés (ce qui augmente leur recirculation hépatique) et les disaccharides qui n'ont pas été absorbés en amont sont dégradés en chaînes courtes, absorbables sous forme d'acides gras.
Dans l'iléon (principalement à cause du transport plus rapide du chyme), la densité bactérienne est environ 4 fois plus faible que dans le côlon. Le pH peu élevé de l'estomac est un obstacle à la prolifération bactérienne gastrique, si bien qu'à ce niveau comme dans la partie initiale de l'intestin grêle, le nombre de bactéries est très faible (0-104 /ml).